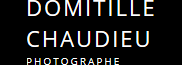
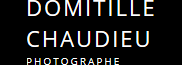
Cénotaphes
Un léger vent de catastrophe souffle sur les paysages de Domitille Chaudieu. Pas un vent de tempête, non, une brise légère, mais constante, qui hante chaque motif jusqu’au cœur de son impassibilité. Rien de spectaculaire, jamais, dans ses photographies. Une maison, des arbres morts, un massif montagneux, une source, un banc de pierre, une saline, une grande serre. Des paysages, donc, saisis au gré des voyages de l’artiste, qui dérouteraient par leur apparente hétérogénéité, s’ils ne suscitaient tous une même sensation : celle d’une chute. Qu’elle photographie une maison en Chine, des arbres morts à Porquerolles, le sommet d’une montagne en Savoie où une pente où git, comme une stèle renversée, un long bloc de béton, c’est le déséquilibre qui retient Chaudieu. Le déséquilibre ou, plutôt, la tension constante entre l’ordre et la ruine. Ainsi, dans cette photo prise en Chine en 2007, la maison paraît-elle d’autant plus stable, d’autant plus rectangulaire, d’autant plus monumentale, qu’elle repose sur l’oblique d’une pente, dont elle vient comme arrêter le glissement. Maison, dit la photographe, mais qui vit dans cette sculpture sans fenêtres ? Dehors, dans le vert du feuillage, trois lampions rouges trahissent par leur léger tremblement la seule présence humaine qui soit : celle de l’artiste au moment où elle déclenche son appareil.
C’est là, dans cette tache de rouge sur du vert, que se tient Domitille Chaudieu. En artiste qui sait, avec une gravité sans phrases, que l’apparente impassibilité du monde n’est qu’un masque derrière lequel gisent, inépuisablement, des images. Il faut posséder ce savoir – et ce qui est beau, chez Domitille Chaudieu, c’est cette façon qu’elle a de sembler sincèrement ignorer qu’elle est porteuse de cela – pour pouvoir affronter la montagne Sainte-Victoire de cette façon-là : dans un parfait retournement de l’obsession minérale cézanienne en une soudaine trouée d’eau où la montagne ne vient pas même se refléter. Il faut de la force, et même de la violence, pour affronter ça. Comme il en faut pour faire face à la source de la Loue. Parce qu’on est devant le gigantesque et le sublime. Et parce que Gustave Courbet est passé par là. Or, face à cela, Chaudieu ne vient pas désarmée, mais nourrie de peinture. Et peu importe qu’elle dise ne pas connaître ce tableau de Caspar David Friedrich, Tombes des héros antiques, auquel cette source de la Loue fait irrésistiblement penser, car son travail, sans jamais se référer à nul tableau précis, ne cesse de nous ramener, par la photographie, à la peinture. Nulle démarche pictorialiste, chez cette artiste, nulle volonté, par la photo, de simuler la peinture. Pas de jeu de citations, mais une façon de regarder, aiguisée devant des tableaux, qui donne à ses photographies ce grain si particulier. Comment nommer autrement ce sens de la couleur qui s’incarne dans la barrière bleue d’une maison de Porquerolles ou dans ces quelques taches orangées qui viennent rompre avec le quasi noir et blanc des Drus, comment évoquer ces blancs de la grande serre du Jardin des Plantes, sans revenir à la peinture, comme source toujours discrètement là ? Il y a, chez cette femme, une façon étrangement sensuelle et rude, en même temps, de restituer la peau du monde. Les aspérités d’une montagne verticale comme celles du sol abrasé d’une saline sont, sous son objectif, le point de coïncidence, si proche, si rugueux, entre le monde et nous. Domitille Chaudieu fait attention au monde. Et chacune de ses photos, quel qu’en soit le cadrage, semble avoir été prise de près, tant, ici, tout motif est comme précipité vers nous. A portée de main, ai-je envie de dire, parce que c’est notre toucher, tout autant que nos yeux, qui est sollicité. Comment voir, c’est-à-dire comment ressentir ce qui se passe dans ce paysage empoussiéré de Porquerolles, où un arbre mort enlace un pilier de ciment, si ce n’est en acceptant d’y risquer son corps, si ce n’est en renonçant à garder ses distances ?
Là, il faut donc entrer. Faire l’expérience de la chute. Glisser le long de ses pentes pour comprendre de quoi ses paysages désertés sont le lieu. Car les photographies de Domitille Chaudieu ne sont pas inoccupées, mais désertées. L’homme, ici, c’est-à-dire l’humain, s’est absenté, et c’est de cette absence que chaque photographie porte la trace et construit le monument. Maison chinoise, arbres morts, parois vertigineuses des Drus, serre hivernale, bloc de béton renversé, poteau d’angle étouffé de végétation morte, tout, chez cette artiste, tend à devenir cénotaphe : ces « tombeaux vides », comme le rappelle l’étymologie grecque, qui font du paysage un monument à la mémoire d’une personne absente.
De cet art mélancolique, une œuvre semble être, dans son unicité même, la matrice paradoxale. C’est une photographie de 2005. On y voit un ours polaire, endormi sans doute, de dos, sur le sol froid d’un zoo. A l’horizontalité de l’ours répond celle d’un tronc d’arbre mort, dérisoire rappel de cette nature auquel l’animal fut arraché. Sans que l’on sache très bien pourquoi, peut-être parce que l’artiste ne nous a pas habitué à capter le vivant, on ne peut s’empêcher de penser que l’ours est mort. A moins que cela ne soit dû à la présence de ces quelques feuilles vertes posées devant la patte de l’animal, qui rappellent, le rouge en moins, ces roses que l’on dépose sur les tombeaux des êtres aimés. Petite tache de vert sur fond gris.
Pierre Wat.