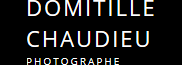
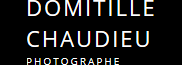
L’éboulis qui vient
Il y a ce blanc, qui est sans doute fait de neige, mais qui est surtout fait d’aveuglement, et envahit le bas de l’image, telle une nappe coulant vers nous. Et il y a cette pente, juste derrière, d’où la végétation paraît arrachée : présente, encore, mais seulement sous la forme de quelques arbustes morts, et de traînées noirâtres, comme les traces sales de cet arrachement. Devant, le blanc qui vient vers nous, derrière, la pente d’où tout provient. Etrange paysage que celui de Domitille Chaudieu – et j’utilise ici ce singulier possessif parce que je suis convaincu que d’une photo l’autre, au-delà du leurre de diversité, c’est bien son lieu que saisit l’artiste – étrange paysage, en effet, d’où la nature est littéralement chassée, au profit d’une pente abrasée et d’une nappe blanche qui vient, telle une force éblouissante, vers nous. Les amateurs de pittoresque seront déçus.
Pourtant, Domitille Chaudieu voyage – elle a même été en Chine – et c’est de ces moments d’éloignement (elle vit à Paris) qu’elle rapporte la plupart de ses images. Mais, chez elle, le voyage est moins un déplacement vers le lointain, la quête d’un exotisme, ou un improbable désir de se livrer à un inventaire des particularités du beau, qu’une façon, nécessaire, de faire un pas de côté. Peu importe la distance, s’il peut en surgir du décentrement. Qu’elle aille en Chine, dans les Alpes, à Porquerolles ou au Jardin des Plantes, Chaudieu ne va pas plus ou moins loin : elle va, littéralement, ailleurs, non pas dans des variantes de ce que le monde offre de paysages, mais, au contraire, juste à côté. Tout, ici, est affaire de cadrage, et le seul vrai voyage est celui qui consiste à savoir déplacer légèrement son objectif, pour saisir cette marge qui se cache en bordure du monde, juste à la lisière du pittoresque, juste à l’extérieur de ces millions de sites que les voyageurs en mal de belles images jugent dignes d’être mis en boîte. Oh, rien de spectaculaire dans ce petit pas de côté. L’artiste n’est pas amateur de grands effets, d’images efficaces, qui substitueraient le laid au joli, la catastrophe aux joies de la découverte des lointains inconnus. Non, faire un pas de côté, c’est peu, mais c’est l’exacte distance qu’il faut franchir si l’on veut s’arrêter à la marge, dans cet entre-deux qui est le lieu frontalier entre paysage et blanc de l’aveuglement. Lieu sans nom, car empruntant sa nature aux deux espaces dont il instaure la jonction, comme un terrain vague ou ce que, autrefois, on appelait la Zone.
La Zone : cette bande de terre juste en avant du mur d’enceinte de Paris, sur laquelle il était interdit de construire quoi que ce soit. Même les arbres y avaient été coupés afin de dégager la vue aux défenseurs. C’était cela, cet entre-deux : la « zone non aedificandi », un lieu abrasé, interdit à la construction, comme un chantier condamné à l’éternel abandon, une fois le premier travail de mise à nu effectué. Et c’est à cela, de fait, que me fait songer le travail de Domitille Chaudieu. Chine ou montagne, à quoi donc ressemble son monde, si ce n’est à un chantier déserté juste avant la catastrophe ? Juste avant, dans cet instant d’assourdissant silence qui, en montagne, précède l’avalanche. Comment dire autrement le sentiment qui naît de l’absence de tout être vivant dans ses photographies ? Comment l’expliquer autrement que par le fait qu’ils ont fui ? Les paysages de Chaudieu ne sont pas inhabités, ils sont abandonnés, désertés. Sans doute faut-il regarder ses œuvres dans l’ordre où le présent catalogue les propose, pour prendre la mesure de ce qui, ici, a été fui. Je veux parler de cette façon, par exemple, dont paysages de Chine et de montagne alternent, parfois, comme dans un souci non pas de diversité, mais de conjonction entre des images qu’unissent des liens de causalité. Quoi de plus dissemblable, en apparence, que cette vue d’une place, en Chine, qu’ornent quelques arbres semblables à des poteaux télégraphiques désolés, et cette pente hérissée de souches qui sont comme autant de stèles renversées dans un cimetière sous la neige ? D’un côté l’ordre et la planéité d’un promontoire construit, de l’autre la pente qui, une fois encore, se précipite vers nous. Mais ici, disais-je, tout est affaire de cadrage, et au bord de la photographie de Chine, juste à la marge gauche, à sa limite donc, on aperçoit une poubelle orange et verte, manière de briser le pittoresque qui menace, et rappel à l’ordre du devenir de ce qui paraissait le plus immuable. C’est cela le rapport des images entre elles, tel qu’il s’instaure dans l’œuvre de Domitille Chaudieu : un rappel à l’ordre de ce vers quoi le temps nous mène, qui fait de chacune de ses œuvres une Vanité. On comprend, dès lors, ce que les absents ont fui.
A rapprocher ainsi les images, à se souvenir, comme le fait l’artiste, que seul l’art peut commenter l’art, on perçoit ce qui peut peser de menaces sur les images qui sembleraient de prime abord les plus calmes. Ainsi de cet autre arbre chinois, certes si beau, si graphique, si oriental dans sa façon d’inscrire son ombre dans l’enclos minéral où il vit, dont, soudain, après avoir regardé une autre photographie où une coulée de sapins noirs vient déchirer la blancheur d’une pente, on se demande si, plutôt que de l’ombre, cette trace n’est pas celle d’un sol se fissurant sous l’effet d’on ne sait quel tremblement de terre. Oui, décidément, on comprend pourquoi d’un tel monde désolé les hommes se sont échappés, laissant une nature qui n’est faite que de racines et de lianes hérissées enlaçant des ruines jusqu’à les étouffer.
Domitille Chaudieu, elle, ne fuit pas : elle affronte l’éboulis qui vient. Folie ? Certainement pas. Lucidité, plutôt, de qui sait que l’expérience tragique du temps ne peut se vivre qu’en se tenant debout, face à face, les yeux ouverts jusqu’à l’aveuglement. C’est pour cela que Chaudieu fait des photographies : pas pour produire des images, mais pour éprouver, physiquement, ce chemin qu’est le temps, et laisser à ceux qui ont fui quelques traces des stations où elle s’est, pour un temps, arrêtée.
Pierre Wat.